La mort de Roland
Roland lui-même sent que la mort lui est proche ;
2260 Sa cervelle s’en va par les oreilles...
Le voilà qui prie pour ses pairs d’abord, afin que Dieu les appelle,
Puis il se recommande à l’ange Gabriel.
Prist l’olifant, que reproce n’en ait, Il prend l’olifant d’une main (pour n’en pas avoir de reproche),
Et de l’autre saisit Durendal, son épée.
2265 Il s’avance plus loin qu’une portée d’arbalète,
Il s’avance sur la terre d’Espagne, entre en un champ de blé,
Sous deux beaux arbres
y a là quatre perrons de marbre.
Roland tombe à l’envers sur l’herbe verte,
Et se pâme ; car la mort lui est proche.
Les puys sont hauts, hauts sont les arbres.
Il y a là quatre perrons, tout luisants de marbre.
Sur l’herbe verte le comte Roland se pâme.
Cependant un Sarrasin l’épie,
Qui contrefait le mort et gît parmi les autres ;
Il a couvert de sang son corps et son visage.
Soudain il se redresse, il accourt ;
Il est fort, il est beau et de grande bravoure.
Plein d’orgueil et de mortelle rage,
Il saisit Roland, corps et armes,
Et s’écrie : « Vaincu, il est vaincu, le neveu de Charles !
« Voilà son épée que je porterai en Arabie. »
Comme il la tirait, Roland sentit quelque chose...
Roland s’aperçoit qu’on lui enlève son épée ;
Il ouvre les yeux, ne dit qu’un mot :
« Tu n’es pas des nôtres, que je sache ! »
De son olifant, qu’il ne voudrait point lâcher,
Il frappe un rude coup sur le heaume tout gemmé d’or,
Brise l’acier, la tête et les os du païen,
Lui fait jaillir les deux yeux hors du chef,
Et le retourne mort à ses pieds :
« Lâche, dit-il, qui t’a rendu si osé,
« À tort ou à droit, de mettre la main sur Roland ?
« Qui le saura t’en estimera fou.
« Le pavillon de mon olifant en est fendu ;
" L’or et les pierreries en sont tombés. »
Roland sent bien qu’il a perdu la vue :
Il se lève, il s’évertue tant qu’il peut ;
Las ! son visage n’a plus de couleurs.
Devant lui est une roche brune ;
Par grande douleur et colère, il y assène dix forts coups ;
L’acier de Durendal grince : point ne se rompt, ni ne s’ébrèche :
« Ah ! sainte Marie, venez à mon aide, dit le comte.
« Ô ma bonne Durendal, quel malheur !
« Me voici en triste état, et je ne puis plus vous défendre ;
« Avec vous j’ai tant gagné de batailles !
« J’ai tant conquis de vastes royaumes
« Que tient aujourd’hui Charles à la barbe chenue !
« Ne vous ait pas qui fuie devant un autre !
« Car vous avez été longtemps au poing d’un brave,
« Tel qu’il n’y en aura jamais en France, la terre libre. »
Roland frappe une seconde fois au perron de sardoine ;
L’acier grince : il ne rompt pas, il ne s’ébrèche point.
Quand le comte s’aperçoit qu’il ne peut briser son épée,
En dedans de lui-même il commence à la plaindre :
« Ô ma Durendal, comme tu es claire et blanche !
« Comme tu luis et flamboies au soleil !
« Je m’en souviens : Charles était aux vallons de Maurienne,
« Quand Dieu, du haut du ciel, lui manda par un ange
« De te donner à un vaillant capitaine.
« C’est alors que le grand, le noble roi la ceignit à mon côté...
« Avec elle je lui conquis l’Anjou et la Bretagne ;
« Je lui conquis le Poitou et le Maine ;
« Je lui conquis la libre Normandie ;
« Je lui conquis Provence et Aquitaine,
« La Lombardie et toute la Romagne ;
« Je lui conquis la Bavière et les Flandres,
« Et la Bulgarie et la Pologne,
« Constantinople qui lui rendit hommage,
« Et la Saxe qui se soumit à son bon plaisir ;
« Je lui conquis Écosse, Galles, Irlande
« Et l’Angleterre, son domaine privé.
« Cunquis l’en ai païs e teres tantes, terres,
« Que tient Charles à la barbe chenue !
« Et maintenant j’ai grande douleur à cause de cette épée.
« Plutôt mourir que de la laisser aux païens !
« Que Dieu n’inflige point cette honte à la France ! »
Pour la troisième fois, Roland frappe sur une pierre bise :
Plus en abat que je ne saurais dire.
L’acier grince ; il ne rompt pas :
L’épée remonte en amont vers le ciel.
Quand le comte s’aperçoit qu’il ne la peut briser,
Tout doucement il la plaint en lui-même :
« Ma Durendal, comme tu es belle et sainte !
« Dans ta garde dorée il y a assez de reliques :
« Une dent de saint Pierre, du sang de saint Basile.
« Des cheveux de monseigneur saint Denis,
« Du vêtement de la Vierge Marie.
« Non, non, ce n’est pas droit que païens te possèdent !
« Ta place est seulement entre des mains chrétiennes.
« Plaise à Dieu que tu ne tombes pas entre celles d’un lâche !
« Combien de terres j’aurai par toi conquises,
« Que tient Charles à la barbe fleurie,
« Et qui sont aujourd’hui la richesse de l’Empereur ! »
Roland sent que la mort l’entreprend
Et qu’elle lui descend de la tête sur le cœur.
Il court se jeter sous un pin ;
Sur l’herbe verte il se couche face contre terre ;
Il met sous lui son olifant et son épée,
Et se tourne la tête du côté des païens.
Et pourquoi le fait-il ? Ah ! c’est qu’il veut
Faire dire à Charlemagne et à toute l’armée des Francs
Le noble comte, qu’il est mort en conquérant.
Il bat sa coulpe, il répète son Mea culpa.
Pour ses péchés, au ciel il tend son gant...
Roland sent bien que son temps est fini.
Il est là au sommet d’un pic qui regarde l’Espagne ;
D’une main il frappe sa poitrine :
« Mea culpa, mon Dieu, et pardon au nom de ta puissance,
« Pour mes péchés, pour les petits et pour les grands,
« Pour tous ceux que j’ai faits depuis l’heure de ma naissance
« Jusqu’à ce jour où je suis parvenu. »
Il tend à Dieu le gant de sa main droite,
Et voici que les Anges du ciel s’abattent près de lui.
Il est là gisant sous un pin, le comte Roland ;
Il a voulu se tourner du côté de l’Espagne.
Il se prit alors à se souvenir de plusieurs choses :
De tous les royaumes qu’il a conquis,
Et de douce France, et des gens de sa famille,
Et de Charlemagne, son seigneur qui l’a nourri ;
Il ne peut s’empêcher d’en pleurer et de soupirer.
Mais il ne veut pas se mettre lui-même en oubli,
Et, de nouveau, réclame le pardon de Dieu :
« Ô notre vrai Père, dit-il, qui jamais ne mentis,
« Qui ressuscitas saint Lazare d’entre les morts
« Et défendis Daniel contre les lions,
« Sauve, sauve mon âme et défends-la contre tous périls,
« À cause des péchés que j’ai faits en ma vie. »
a tendu à Dieu le gant de sa main droite :
Saint Gabriel l’a reçu.
Alors sa tête s’est inclinée sur son bras,
Et il est allé, mains jointes, à sa fin.
Dieu lui envoie un de ses anges chérubins
Et saint Michel du Péril.
Saint Gabriel est venu avec eux :
L’âme du comte est emportée au Paradis...
Roland lui-même sent que la mort lui est proche ;
2260 Sa cervelle s’en va par les oreilles...
Le voilà qui prie pour ses pairs d’abord, afin que Dieu les appelle,
Puis il se recommande à l’ange Gabriel.
Prist l’olifant, que reproce n’en ait, Il prend l’olifant d’une main (pour n’en pas avoir de reproche),
Et de l’autre saisit Durendal, son épée.
2265 Il s’avance plus loin qu’une portée d’arbalète,
Il s’avance sur la terre d’Espagne, entre en un champ de blé,
Sous deux beaux arbres
y a là quatre perrons de marbre.
Roland tombe à l’envers sur l’herbe verte,
Et se pâme ; car la mort lui est proche.
Les puys sont hauts, hauts sont les arbres.
Il y a là quatre perrons, tout luisants de marbre.
Sur l’herbe verte le comte Roland se pâme.
Cependant un Sarrasin l’épie,
Qui contrefait le mort et gît parmi les autres ;
Il a couvert de sang son corps et son visage.
Soudain il se redresse, il accourt ;
Il est fort, il est beau et de grande bravoure.
Plein d’orgueil et de mortelle rage,
Il saisit Roland, corps et armes,
Et s’écrie : « Vaincu, il est vaincu, le neveu de Charles !
« Voilà son épée que je porterai en Arabie. »
Comme il la tirait, Roland sentit quelque chose...
Roland s’aperçoit qu’on lui enlève son épée ;
Il ouvre les yeux, ne dit qu’un mot :
« Tu n’es pas des nôtres, que je sache ! »
De son olifant, qu’il ne voudrait point lâcher,
Il frappe un rude coup sur le heaume tout gemmé d’or,
Brise l’acier, la tête et les os du païen,
Lui fait jaillir les deux yeux hors du chef,
Et le retourne mort à ses pieds :
« Lâche, dit-il, qui t’a rendu si osé,
« À tort ou à droit, de mettre la main sur Roland ?
« Qui le saura t’en estimera fou.
« Le pavillon de mon olifant en est fendu ;
" L’or et les pierreries en sont tombés. »
Roland sent bien qu’il a perdu la vue :
Il se lève, il s’évertue tant qu’il peut ;
Las ! son visage n’a plus de couleurs.
Devant lui est une roche brune ;
Par grande douleur et colère, il y assène dix forts coups ;
L’acier de Durendal grince : point ne se rompt, ni ne s’ébrèche :
« Ah ! sainte Marie, venez à mon aide, dit le comte.
« Ô ma bonne Durendal, quel malheur !
« Me voici en triste état, et je ne puis plus vous défendre ;
« Avec vous j’ai tant gagné de batailles !
« J’ai tant conquis de vastes royaumes
« Que tient aujourd’hui Charles à la barbe chenue !
« Ne vous ait pas qui fuie devant un autre !
« Car vous avez été longtemps au poing d’un brave,
« Tel qu’il n’y en aura jamais en France, la terre libre. »
Roland frappe une seconde fois au perron de sardoine ;
L’acier grince : il ne rompt pas, il ne s’ébrèche point.
Quand le comte s’aperçoit qu’il ne peut briser son épée,
En dedans de lui-même il commence à la plaindre :
« Ô ma Durendal, comme tu es claire et blanche !
« Comme tu luis et flamboies au soleil !
« Je m’en souviens : Charles était aux vallons de Maurienne,
« Quand Dieu, du haut du ciel, lui manda par un ange
« De te donner à un vaillant capitaine.
« C’est alors que le grand, le noble roi la ceignit à mon côté...
« Avec elle je lui conquis l’Anjou et la Bretagne ;
« Je lui conquis le Poitou et le Maine ;
« Je lui conquis la libre Normandie ;
« Je lui conquis Provence et Aquitaine,
« La Lombardie et toute la Romagne ;
« Je lui conquis la Bavière et les Flandres,
« Et la Bulgarie et la Pologne,
« Constantinople qui lui rendit hommage,
« Et la Saxe qui se soumit à son bon plaisir ;
« Je lui conquis Écosse, Galles, Irlande
« Et l’Angleterre, son domaine privé.
« Cunquis l’en ai païs e teres tantes, terres,
« Que tient Charles à la barbe chenue !
« Et maintenant j’ai grande douleur à cause de cette épée.
« Plutôt mourir que de la laisser aux païens !
« Que Dieu n’inflige point cette honte à la France ! »
Pour la troisième fois, Roland frappe sur une pierre bise :
Plus en abat que je ne saurais dire.
L’acier grince ; il ne rompt pas :
L’épée remonte en amont vers le ciel.
Quand le comte s’aperçoit qu’il ne la peut briser,
Tout doucement il la plaint en lui-même :
« Ma Durendal, comme tu es belle et sainte !
« Dans ta garde dorée il y a assez de reliques :
« Une dent de saint Pierre, du sang de saint Basile.
« Des cheveux de monseigneur saint Denis,
« Du vêtement de la Vierge Marie.
« Non, non, ce n’est pas droit que païens te possèdent !
« Ta place est seulement entre des mains chrétiennes.
« Plaise à Dieu que tu ne tombes pas entre celles d’un lâche !
« Combien de terres j’aurai par toi conquises,
« Que tient Charles à la barbe fleurie,
« Et qui sont aujourd’hui la richesse de l’Empereur ! »
Roland sent que la mort l’entreprend
Et qu’elle lui descend de la tête sur le cœur.
Il court se jeter sous un pin ;
Sur l’herbe verte il se couche face contre terre ;
Il met sous lui son olifant et son épée,
Et se tourne la tête du côté des païens.
Et pourquoi le fait-il ? Ah ! c’est qu’il veut
Faire dire à Charlemagne et à toute l’armée des Francs
Le noble comte, qu’il est mort en conquérant.
Il bat sa coulpe, il répète son Mea culpa.
Pour ses péchés, au ciel il tend son gant...
Roland sent bien que son temps est fini.
Il est là au sommet d’un pic qui regarde l’Espagne ;
D’une main il frappe sa poitrine :
« Mea culpa, mon Dieu, et pardon au nom de ta puissance,
« Pour mes péchés, pour les petits et pour les grands,
« Pour tous ceux que j’ai faits depuis l’heure de ma naissance
« Jusqu’à ce jour où je suis parvenu. »
Il tend à Dieu le gant de sa main droite,
Et voici que les Anges du ciel s’abattent près de lui.
Il est là gisant sous un pin, le comte Roland ;
Il a voulu se tourner du côté de l’Espagne.
Il se prit alors à se souvenir de plusieurs choses :
De tous les royaumes qu’il a conquis,
Et de douce France, et des gens de sa famille,
Et de Charlemagne, son seigneur qui l’a nourri ;
Il ne peut s’empêcher d’en pleurer et de soupirer.
Mais il ne veut pas se mettre lui-même en oubli,
Et, de nouveau, réclame le pardon de Dieu :
« Ô notre vrai Père, dit-il, qui jamais ne mentis,
« Qui ressuscitas saint Lazare d’entre les morts
« Et défendis Daniel contre les lions,
« Sauve, sauve mon âme et défends-la contre tous périls,
« À cause des péchés que j’ai faits en ma vie. »
a tendu à Dieu le gant de sa main droite :
Saint Gabriel l’a reçu.
Alors sa tête s’est inclinée sur son bras,
Et il est allé, mains jointes, à sa fin.
Dieu lui envoie un de ses anges chérubins
Et saint Michel du Péril.
Saint Gabriel est venu avec eux :
L’âme du comte est emportée au Paradis...
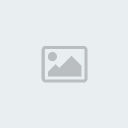
 Accueil
Accueil